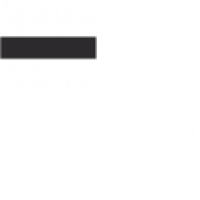
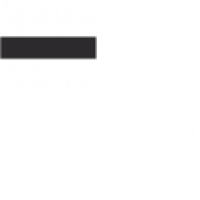

Contexte et justification du projet :
Le Niger est un vaste territoire enclavé et aride (la zone saharienne représente les deux tiers de la surface du pays). Sa superficie est de 1 267 000 km², et le pays s’étend entre 11°37′ et 23°33′ de latitude nord, et entre 0°06′ et 16°00′ de longitude est. Niamey, la capitale, se trouve à 1 035 km de Cotonou, capitale économique de la République du Bénin et port maritime le plus proche.
Le Niger est limité au nord par l’Algérie et la Libye, à l’est par le Tchad, au sud par le Nigeria et le Bénin, et à l’ouest par le Burkina Faso et le Mali.
Le trait marquant du climat du Niger est la sécheresse liée à plusieurs facteurs :
L’insuffisance des précipitations : de l’extrême sud, qui reçoit plus de 800 mm par an, elles diminuent très rapidement selon un axe SO-NE, et s’abaissent à moins de 100 mm au nord et à l’est du pays. Les pluies, généralement orageuses, ont par conséquent un effet fortement érosif.
Les températures élevées : la moyenne annuelle est comprise entre 27° et 29 °C, avec une amplitude annuelle inférieure à l’amplitude moyenne diurne (particulièrement dans le nord), ce qui est caractéristique d’un climat typiquement tropical.
La forte évaporation : à Agadez et à Bilma, on enregistre plus de 4 mètres de hauteur d’eau évaporée par an sous abri. Elle décroît vers le sud en lien avec l’augmentation de l’humidité relative. Partout, à l’exception du département de Gaya, la sécheresse constitue une contrainte majeure du climat nigérien.
La zone d’intervention du projet (communes I et IV de Niamey) est définie par une pluviométrie moyenne comprise entre 400 et 600 mm annuels. Les écosystèmes présents sont caractéristiques des zones de transition. La végétation est constituée de savanes arbustives ou arborées, avec des taux de recouvrement assez variés. C’est une zone de fortes potentialités agricoles, tant en pluvial qu’en irrigué. Les cultures les plus répandues restent les céréales, mais les cultures de rente et maraîchères occupent une place importante dans les sources de revenus des ménages. L’élevage y est pratiqué et fortement intégré à l’agriculture sous forme d’agro-pastoralisme.
Le système agro-pastoral est caractérisé par les céréales en pluvial (mil, sorgho) associées aux légumineuses (niébé), avec un bon équilibre entre l’agriculture et l’élevage au niveau des exploitations. La riziculture est également pratiquée dans les périmètres irrigués, sur près de 13 000 hectares d’aménagements hydroagricoles.
Les ressources naturelles, situées sur le quart du territoire national, sont en dégradation continue sous les effets conjugués des facteurs anthropiques (défrichements, feux de brousse, surpâturage, etc.) et climatiques (sécheresses, inondations, etc.).
La population est concentrée dans la bande sud, et même dans cette zone, les conditions d’exercice de l’agriculture et de l’élevage sont souvent difficiles du fait de l’insuffisance et de l’irrégularité des précipitations, de la régression des aires de pâturage, et aussi de la faible fertilité des sols. En conséquence, les rendements des cultures pluviales dominantes au Niger – mil, sorgho, niébé, arachide – sont généralement faibles, et les possibilités d’extension des cultures apparaissent limitées. Les pertes de forêts sont estimées à 100 000 ha/an (Direction de l’Environnement, 2000), ce qui compromet la satisfaction des différents besoins des populations en bois-énergie, bois de service et terres de culture.
La superficie potentiellement cultivable est estimée à 15 millions d’hectares, représentant moins de 12 % de la superficie totale du pays, tandis que les terres cultivées sont estimées à 6 millions d’ha. Il faut souligner que 80 à 85 % des sols cultivables sont dunaires et seulement 15 à 20 % sont des sols hydromorphes moyennement argileux (SEDES, 1987). Le potentiel en terres irrigables est estimé à 270 000 hectares, soit 4 % de la superficie totale, dont 140 000 hectares sont situés dans la vallée du fleuve Niger. La répartition des terres selon les zones climatiques indique la situation suivante : 65 % des terres se trouvent en zone saharienne (pluviométrie annuelle < 200 mm), 12 % en zone saharo-sahélienne (200 à 300 mm), 12 % en zone sahélienne, 9,8 % en zone soudano-sahélienne et 0,9 % en zone soudanienne (pluviométrie > 600 mm/an).
Les sols sont pauvres et exposés à l’érosion éolienne. Il en résulte une dégradation continue du potentiel de production et des rendements des principales cultures. La pression démographique, conjuguée aux effets du climat, entraîne une dégradation généralisée du potentiel « terre ». Ceci est surtout lié à :
une extension des terres cultivables ;
une rareté et une rotation plus rapide des jachères ;
l’exploitation des terres impropres à l’agriculture.
Au Niger, la pression démographique, avec un taux d’accroissement annuel de 3,6 %, entraîne une surexploitation des sols. On assiste à la colonisation des terres marginales ainsi qu’à une pratique de l’agriculture « minière », c’est-à-dire une agriculture sans ou presque sans apport d’éléments fertilisants. La pratique traditionnelle de régénération de la fertilité des sols (la jachère) a presque disparu. Les sources de matières organiques deviennent de plus en plus rares, et les engrais minéraux deviennent de plus en plus inaccessibles pour les paysans à faible revenu. À cela s’ajoutent les pratiques traditionnelles de l’élevage, qui favorisent le surpâturage. Tous ces facteurs concourent à maintenir le Niger dans une situation d’insécurité alimentaire chronique.
Au Niger, des pluies suffisantes ne sont jamais une certitude (comme en témoignent les famines de 1970, 1974, 1980 et 2005), et une situation d’incertitude continue de planer, notamment avec la flambée des prix des céréales, qui rend difficile l’accès à la nourriture pour la majorité des ménages paysans pauvres.
Depuis plusieurs années, en dépit des efforts engagés, le secteur rural connaît une situation préoccupante. Il s’agit notamment de :
la faible productivité des systèmes de production ;
l’accroissement de la compétition pour l’accès aux ressources naturelles, source de conflits ;
l’exploitation « minière » des ressources naturelles, qui provoque une dégradation parfois irréversible de l’environnement ;
la croissance de la production de céréales de base (2,5 % par an), qui reste inférieure à celle de la population (3,1 %) ;
la difficulté pour les organisations professionnelles à jouer pleinement leur rôle face au désengagement de l’État.
De ce fait, les revenus dont disposent actuellement les ruraux ne leur permettent pas de sortir de la pauvreté : 86 % des pauvres se trouvent en zone rurale.
L’aptitude d’un ménage à gérer ce risque dépend de son degré de vulnérabilité, lui-même défini par la force active disponible au sein du ménage, le cheptel, les biens de production, l’accès aux activités génératrices de revenus, ainsi que le capital social.
Pour remédier à ces multiples problèmes qui entravent le développement de l’agriculture en particulier, et celui de l’économie du Niger en général, l’État nigérien a adopté en janvier 2002 une Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). Cette stratégie, fruit d’un processus participatif et itératif, a reçu le soutien de la communauté des bailleurs de fonds. Son ambition est de parvenir à diminuer l’incidence globale de la pauvreté de 63 % à moins de 50 % à l’horizon 2015. Dans cette perspective, elle assigne au secteur rural une place centrale, considérant qu’il peut et doit jouer un rôle moteur dans l’amélioration de la croissance économique.
C’est dans cette vision que le RESEDA met en œuvre des projets de développement et d’urgence, en partenariat avec ses Partenaires Techniques et Financiers, notamment l’ONG CONEMUND.



Objectif général : Contribuer à l’amélioration de la résilience de la population vulnérable de Niamey, dans une approche d’équité de genre et de respect des droits humains (EBDH).
Objectif spécifique : Accompagner les producteurs ruraux avec égalité femmes-hommes et faciliter l’accès des jeunes à l’emploi dans les communes I et IV.
Résultats du projet :
La production agroécologique de légumes est augmentée dans les deux villages de la commune IV ;
Le système de prévention des crises alimentaires est amélioré dans les deux (2) villages de la commune IV ;
L’autonomisation économique de 305 femmes dans les trois (3) villages des communes I et IV est promue ;
L’organisation et l’intégration dans les chaînes de valeur des cinq (5) coopératives des communes I et IV sont renforcées ;
La formation et l’insertion professionnelle des jeunes dans les deux (2) villages de la commune IV de Niamey sont améliorées ;
Résultat transversal : la situation de référence, les ateliers de lancement et de clôture, ainsi que les réunions du Comité de Suivi sont réalisés.

